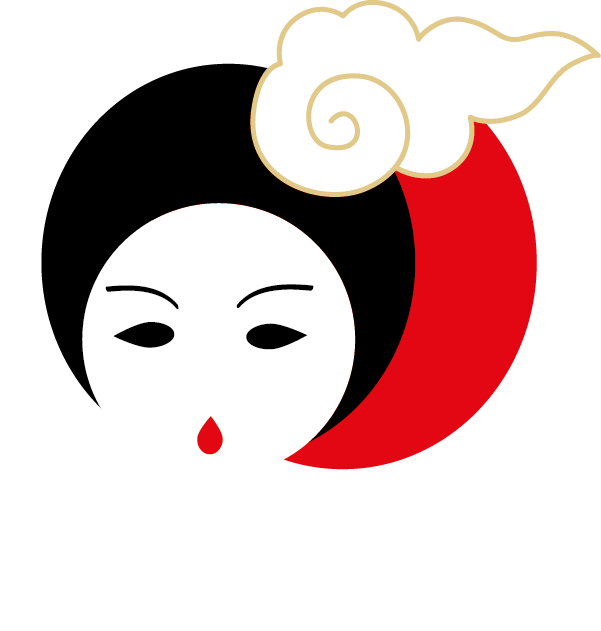Portrait de nihonjin : Kinuko Asano
Instagram : ki_nu_ko
Galerie &co119
119 Rue Vieille du Temple, 75003 Paris.
Instagram : galerie8co119
Hanabi part à la découverte du Japon à travers les yeux de ceux et celles qui y ont été accueillis ou qui en sont originaires : étrangers au Japon (gaijin) ou Japonais (nihonjin) en France, chacun d’entre eux a une histoire simple ou rocambolesque, toujours unique, qui le relie au pays du Soleil Levant. Amour, hasard, travail, ennui : le départ a ses raisons que la raison ignore. Le portrait du Japon qui s’y dégage est celui d’un pays aux mille et unes nuances, privées et palpitantes. Troisième rencontre de notre périple intime : Kinuko Asano, photographe, designer et directrice artistique de la galerie/librairie &co119, à Paris.
Au cœur de Paris, le Marais. Au cœur du Marais, une porte. Derrière la porte, une cour, puis un espace. Cet espace, c’est la galerie et librairie &co119, consacrée prioritairement à la photographie japonaise. Rencontre avec son inspirante directrice artistique, Kinuko Asano.
Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ?
Je m’appelle Kinuko. Je suis une artiste, photographe, designer et directrice artistique free-lance.
C’est comment d’être une Franco-Japonaise en France ? Et au Japon ?
Il est effectivement important de souligner la différence de ressenti dans les deux pays.
En France, les flux migratoires de populations existent depuis toujours. Les frontières ont été déplacées maintes et maintes fois, et le pays appartient à une entité plus grande qui est l’Europe. La multiethnicité fait partie de l’ADN des Français et les réflexions liées à ces mixités sont depuis longtemps abordées.
Dans le cas du Japon, on a un pays géographiquement isolé du reste du monde, qui ne s’est finalement ouvert que très tardivement (en 1854, quand le commandant Matthew Perry met fin à la politique isolationniste de l’archipel par la pression militaire).
Malgré l’ouverture commerciale et politique du pays, l’immigration reste très limitée – seuls 2% des résidents au Japon sont issus de l’immigration, même si la création de deux nouveaux visas en avril de cette année devrait favoriser l’arrivée d’une main d’œuvre étrangère (contre près de 12% en France).
Si on regarde la sémantique, les termes utilisés pour désigner les binationaux renforcent encore plus le sentiment de rejet : alors que le terme politiquement correct est « double », dans le langage courant, les multiethniques sont désignés comme « half », soit « moitiés ». C’est un peu dur quand on y pense, d’être considéré comme valant la moitié de quelqu’un.
Après il y a les similitudes. Par exemple, que ce soit au Japon comme en France, je remarque souvent une fascination pour cette binationalité et cette double culture. La France et le Japon ont toujours eu une fascination mutuelle, notamment sur les plans culturels et culinaires. Des deux côtés, les gens s’imaginent souvent que j’ai pris le meilleur de chaque pays.
Enfin, des deux bords, on a l’exotisation de la femme française/japonaise. D’un côté on a le cliché d’une femme fatale libre et dominante, et de l’autre celui de la jeune fille soumise, docile, au désir débordant dans l’intimité. Dans les deux cas, je ressens souvent le poids d’une étiquette ultra sexualisée.
Quels sont tes grands défis de Franco-Japonaise en France? Et au Japon?
En tant que Franco-japonaise, je crois que mes défis ne se situent pas dans chaque pays. À mon échelle, je souhaiterais réussir à être une sorte de vecteur, de passerelle entre les deux pays. Les différences culturelles et linguistiques sont telles qu’il ne suffit pas de parler les deux langues pour faire en sorte que les deux partis se comprennent. Il faut réussir à traduire les émotions, les enjeux, les attentes.
Concrètement, je crois que pour moi ça se traduit par essayer de parler de certains concepts ou manières de vivre : parler du omotenashi, de otsukare sama et de umami aux Français, de l’art de vivre à la française avec les apéro et les cafés en terrasse, de l’engagement citoyen dans la politique (grèves et manifestations) et le rapport à l’Europe. Ce sont de petites choses, mais c’est avant tout parler de la manière dont le langage et les mœurs influencent la pensée même.
Au quotidien, je travaille aussi en temps que directrice artistique à la galerie et librairie photographique Galerie &co119. L’espace est dans le Marais. On a énormément de livres photos japonais et environ 70 à 80% des artistes qu’on expose sont japonais. En fait, au départ, les photographes japonais faisaient des images pour faire des livres, et non des tirages. C’est assez particulier dans le paysage photographique. Travailler dans cet espace c’est aussi un moyen pour moi d’avoir ce rôle de passerelle.
Quelle est la toute première sensation que tu éprouves quand tu remets les pieds au Japon?
C’est peut-être plus un mot, mais qui traduit une sensation aussi : tadaima, la sensation d’être rentré chez soi, de manière complètement instinctive.
Y a-t-il quelque chose qui te manque du Japon quand tu es en France et de la France quand tu es au Japon ?
La nourriture ! Les sashimi, les tamagoyaki, le ikura et les tarako pastas en France, et l’apéro avec du fromage bien odorant au Japon.
Il y a aussi de petites choses un peu plus immatérielles, mais je me suis rendue compte que les sons de Tokyo me manquent de temps à autres. J’avais été assez émue en allant voir Les délices de Tokyo au cinéma. Naomi Kawase a une manière de capter ces petits bruissements, les croassements des corbeaux et les mille petits sons de Tokyo qui est assez folle. Ça m’a rendue immédiatement nostalgique.
Au Japon, c’est plus sur le côté social qu’il m’arrive de regretter la France. Ce n’est qu’en rentrant au Japon après avoir passé quelques années en France que je me suis rendue compte à quel point entendre ma caissière se plaindre me manquait. C’est assez libérateur, finalement, de ne pas avoir à toujours spéculer sur l’état d’esprit et l’humeur des gens. Que toutes les émotions soit affichées et clamées, ça m’a vraiment choquée quand j’ai déménagé en France à 18 ans, mais maintenant, ça fait vraiment partie des choses que j’apprécie.
Quel est ton mot préféré en français et en japonais et pourquoi ?
En français, j’en parlais avant mais je crois que j’aime vraiment beaucoup le mot apéro. Ça dépeint une activité, un concept qui implique le convivial et un moment partagé à plusieurs. Ça renvoie, en gros, à un art de vivre et de savoir-vivre. Tout ça dans un mot, qui est lui-même une abréviation d’un autre mot ! Le flegme à la française.
En japonais, j’ai toujours eu un rapport assez particulier au mot tadaima, qui est une expression utilisée lorsque l’on rentre chez soi, qui pourrait être traduit part « je suis rentré ». C’est d’ailleurs le titre d’une de mes séries photographiques. Il y a ce côté réconfortant d’affirmer son sentiment d’appartenance au Japon et à une famille, la sous-jacente évidence d’un foyer, et en même temps c’est très exclusif, finalement. L’auteur Akira Mizubayashi en parle bien mieux que moi dans son petit livre Petit éloge de l’errance, où il développe sa réflexion sur le mot okaeri, (« bienvenue à la maison », intrinsèquement lié à tadaima). Je recommande d’ailleurs à toutes les personnes intéressées par la réflexion Franco-Japonaise cet ouvrage.
Quels sont tes projets pour l’avenir ? Qu’as-tu encore à apprendre ?
J’ai mis longtemps à trouver ma place, à définir mon identité entre ces deux cultures. Je crois que c’est encore un peu en construction. Je me demande si ça n’évoluera pas toute ma vie, au fur et à mesure que le Japon et la France évolueront aussi.
Sur un plan plus pragmatique et à court terme, je suis en train de finir une série photographique sur mon expérience aux Etats-Unis, où j’ai habité de 2016 à 2017. J’aimerais terminer cette série d’ici 2019 et trouver un espace pour l’exposer en 2020.
(Propos recueillis par Eloisa Del Giudice)
 Exposition Le Monde de Shoji Ueda à la Galerie &co119, 04.2019 © Kinuko Esther Asano – Galerie &co119
Exposition Le Monde de Shoji Ueda à la Galerie &co119, 04.2019 © Kinuko Esther Asano – Galerie &co119