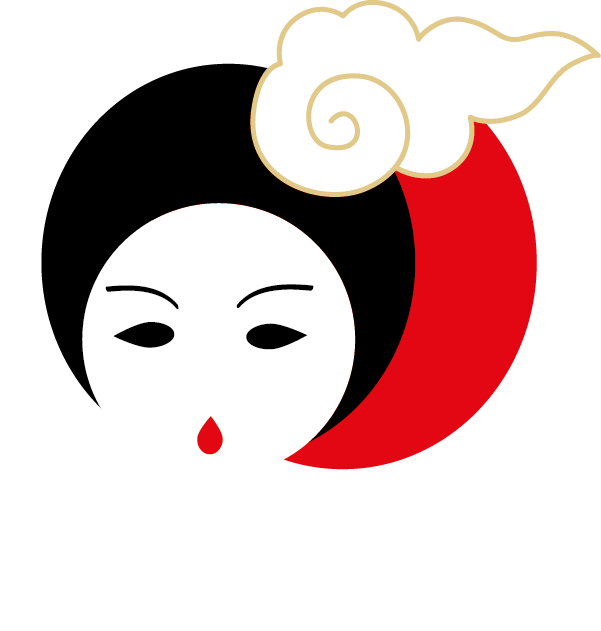Hanabi part à la découverte du Japon à travers les yeux de ceux et celles qui y ont été accueillis ou qui en sont originaires : étrangers au Japon (gaijin) ou Japonais en France, chacun d’entre eux a une histoire simple ou rocambolesque, toujours unique, qui le relie au pays du Soleil Levant. Amour, hasard, travail, ennui : le départ a ses raisons que la raison ignore. Le portrait du Japon qui s’y dégage est celui d’un pays aux mille et unes nuances, privées et palpitantes. Première rencontre de notre périple intime : Martino Cappai, historien de l’art, céramiste et directeur artistique du centre d’Art Brut Yakunosato, résidant sur l’île de Yakushima.
Quand je lui écris pour lui poser mes questions, mon gaijin, Martino vient d’être jeté par les éléments sur la petite île de Tanegashima suite à une tempête en mer, une pluie de cendres volcaniques et une panne au moteur du bateau. Il réussira, après moult péripéties, à rejoindre les forêts de Kamakura et à nous livrer un entretien aussi palpitant et aventureux que la mer force 4, et aussi à vif et plein de grâce que les fêlures dorées du kintsugi.
Qui es-tu ? Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
À en croire mes papiers, je suis un historien de l’art naufragé au pays du Soleil Levant. Je suis originaire de la Sardaigne et, après une licence à l’Université de Cagliari, j’ai obtenu mon master en histoire de l’art contemporain à l’université de Sienne. Après deux ans d’enseignement, séminaires et conférences d’histoire de l’art dans de nombreuses réalités scolaires de Tokyo, je me trouve à présent – suite à une rocambolesque série d’événements – dans une île frontalière perdue au sud de la région de Kyushu, appelée Yakushima. J’y suis arrivé il y a un an très exactement : je voulais m’échapper de la folie urbaine de Tokyo. Dans un moment de folie j’ai démissionné de tous les instituts avec lesquels je collaborais et j’ai choisi l’endroit le plus sauvage et reculé que je connaissais : l’île de Yakushima. Deux mille mètres de montagnes recouvertes de forêt vierge à pic sur le Pacifique. Mon visa durait encore neuf mois, j’avais l’intention de faire une expérience dans un endroit en dehors du monde et de retourner ensuite en Italie. Le premier mois sur l’île j’ai fait les boulots les plus disparates : de serveur, bien évidemment, à bûcheron, de la mise en sécurité des sentiers de montagne à quelques journées en tant que pêcheur de flyfish (la vraie spécialité de l’île). Puis, à travers une amie, j’ai été contacté par le directeur d’un immense centre pour handicapés établi sur l’île. Il voulait me rencontrer pour parler de son projet, la mise en place d’un centre d’Art Brut sur l’île, et me confier les ateliers de dessin, céramique et gestion de la galerie. Voilà ce que je fais… pour l’instant !
Tu te rappelles la toute première sensation que tu as ressenti quand tu as débarqué au Japon ?
Bien sûr ! Le béton. L’énorme quantité de béton : autoroutes, gratte-ciels, ponts gigantesques, lumières… L’arrivée à l’aéroport de Narita et le voyage vers le centre de Tokyo ont été comme une descente dantesque dans les entrailles de la modernité. Je venais des plages de la Sardaigne et des douces collines de Toscane, c’était ma première rencontre avec une réalité urbaine vaste et complexe comme celle de Tokyo qui, je le rappelle, compte 120 millions d’habitants dans sa région.
C’est toi qui as choisi le Japon et le Japon t’a choisi ?
À la fac, j’avais de nombreux intérêts liés au Soleil Levant. Pas de manga ou de jeux vidéos comme c’est le cas pour beaucoup, mais une question plus particulière liée à la chasse à la baleine. Je m’explique : un ami, Michele Barbaro, faisait des études passionnantes sur les relations entre L’Ecclésiaste de la Bible et Moby Dick de Melville. Il m’a transmis son intérêt grâce à un essai merveilleux sur la chasse à la baleine, Leviathan de Philip Hoare : on y trouvait des histoires incroyables d’anciens rituels shintoïstes liés à la pêche traditionnelle des cachalots. J’en ai été à ce point charmé que dès que j’ai débarqué au Japon j’ai foncé chercher les vieux manuels illustrés au ukiyo-e (la xylographie japonaise) sur le sujet. J’ai réussi à les consulter grâce à Yamamoto san, l’un des plus grands experts de ogué, la chasse à la baleine traditionnelle.
Parallèlement à ce coup-de-foudre pour les chasses aventureuses d’un autre temps, le destin a voulu que je tombe sur une fille japonaise connue pendant mes années de fac. Au début, elle a dû me prendre pour un gaijin fou parce que je farcissais toutes nos conversations avec les délires du capitaine Achab et des questions improbables sur les danses propiciatrices liées à la chasse à la baleine (dont, bien évidemment, elle ne connaissait rien). Elle m’a ouvert les portes de cet univers fascinant et chargé de mystère qu’est celui de la tradition japonaise. Voilà, tel était mon fan de cartes : il ne me restait plus qu’à réserver mon vol.
Quels sont tes grands défis en tant que gaijin, étranger au Japon ?
Il y en a beaucoup. Tout d’abord, la langue, un véritable écueil que même certains Japonais ont du mal à franchir. Il n’est pas rare de tomber sur un Japonais incapable de lire, écrire ou comprendre un idéogramme. C’est une langue complexe et délicate, et tristement larguée dans une mer de néologismes étrangers. Un autre grand, très grand défi est celui de devoir faire des compromis avec une certaine façon trop émotive et peu logique qu’ont les Japonais d’affronter le quotidien. D’un certain point de vue, la raison n’est pas un territoire commun sur lequel engager une discussion. Ils ont des habitudes issues d’une société qui a été longtemps féodale et plongée dans les hiérarchies confucéennes. Comme le dit un cher ami qui a été professeur de linguistique à Kobe : « N’oublie pas que la Révolution Française n’a jamais débarqué ici. » En gardant ce détail à l’esprit on arrive à affronter avec plus de sérénité de nombreuses habitudes japonaises qui, pour un occidental, sont un peu nébuleuses. Après, en ce qui me regarde, je dois faire les comptes avec la tristesse d’une américanisation toujours plus rapide et toujours plus vulgaire. Le tout scandé au rythme d’un « turbocapitalisme » vraiment oppressant et qui dégénère chaque année un peu plus. Tout ça se heurte avec le côté plus traditionnel et religieux du Japon.
Il y a des choses qui te manquent de chez toi ?
Bien sûr. Rien n’est jamais comme chez soi. Ce qui me manque le plus, c’est ma langue. Je crois que notre véritable et unique maison n’est pas un endroit physique mais se trouve là où résonne notre langue – nul besoin de demander à Heidegger ou De Saussure pour le comprendre ! Nous ne sommes faits que de langage et de volonté de nous exprimer, et ici dans « l’empire des Signes » ceci est encore plus évident. Ceci dit, je crois que je n’éterniserai pas au Japon. Je veux rentrer à la maison. Je ne finirai pas comme Moby Dick, harponnée dans les mers du Japon !
Quel est ton mot préféré en japonais et pourquoi ?
勿体ない, « mottaïnaï », un pilier du bon sens social japonais. C’est une exclamation qui exprime le regret pour le gaspillage des objets et de la nourriture, liée aux origines très humbles du peuple nippon. C’est un concept très présent parce qu’il ramène au souvenir et au respect pour la rudesse de la vie d’autrefois. Il est présent à tel point qu’un grand Japonais, Daisetsu Suzuki, le plus important représentant en Occident du bouddhisme Zen, ouvrait toutes ses conférences avec la phrase : « Avant toute chose, je viens d’un pays pauvre… ».
Quels sont tes projets futurs ?
Je vais publier un essai sur les rapports entre Ezra Pound et le Japon. Puis, j’aimerais ouvrir un centre d’Art Brut en Italie, possiblement dans ma Sardaigne natale. Je suis un membre fondateur du centre d’Art Brut Yakunosato et je suis en train d’apprendre beaucoup de choses, autant sur le plan de la gestion que créatif. J’apprends beaucoup des « outsiders », leur créativité est absolument magique, remplie d’une énergie fraîche, non polluée par des exigences du marché ou par une volonté de se faire remarquer. C’est un travail intense, intime, sacré, en contact avec les forces de l’univers.
Que voudrais-tu encore apprendre ?
Plus d’idéogrammes, la teinture à l’indigo, le laquage urushi et les secrets de la céramique japonaise !

Portrait d’un gaijin
Propos recueillis par Eloisa Del Giudice