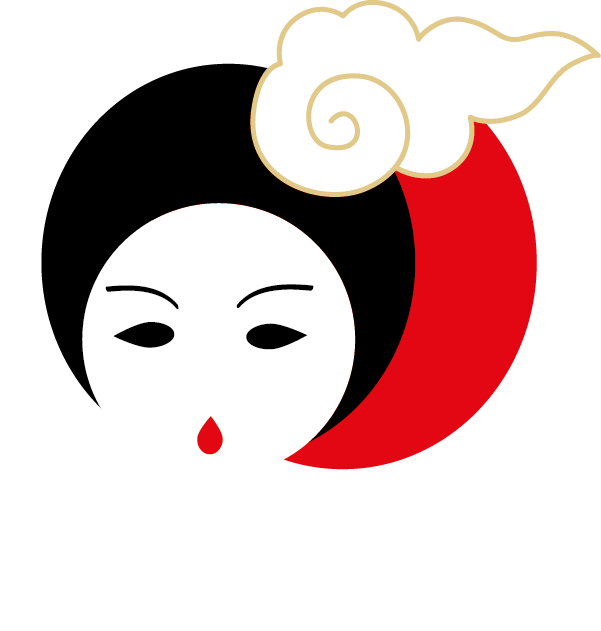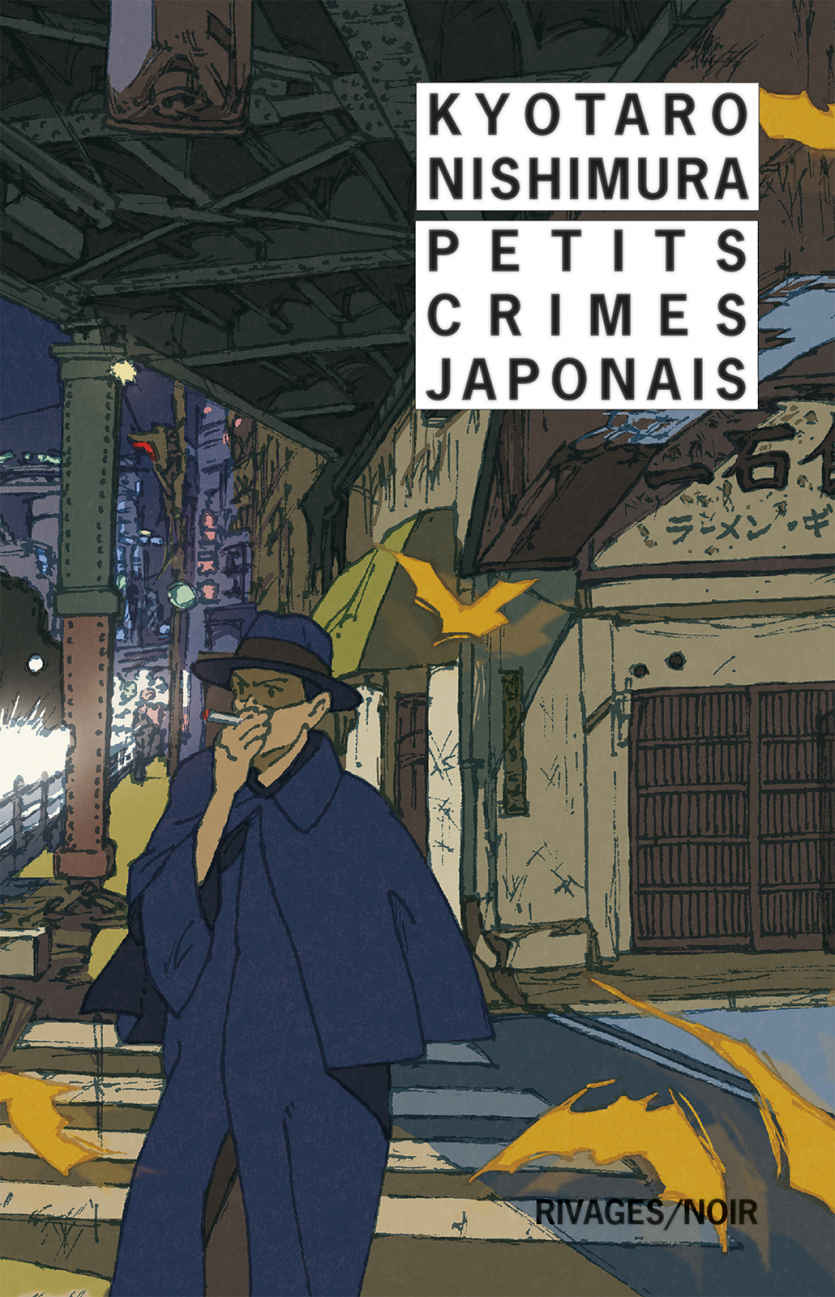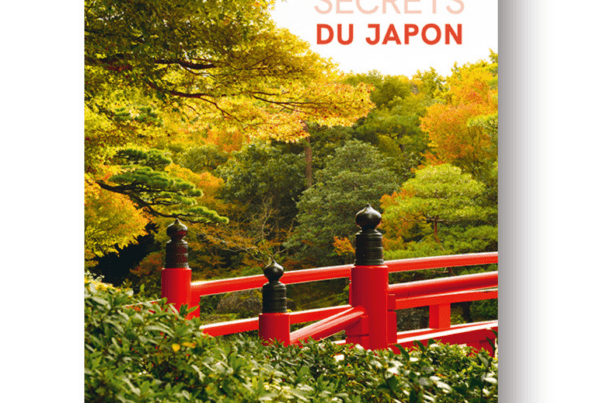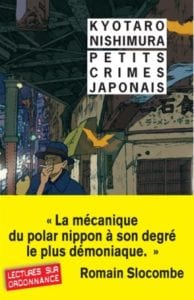 Kyōtarō Nishimura, Petits crimes japonais, Éditions Rivages.
Kyōtarō Nishimura, Petits crimes japonais, Éditions Rivages.
Traduit par Jean-Christian Bouvier
11 x 17 cm
224 pages
Nos autres titres FictionC’est la rentrée, le glas des vacances a sonné, le rythme ternaire du métro-boulot-dodo reprend à cadencer nos vies. Pour attaquer l’année avec ce qu’il faut de malice pour survivre aux premiers réveils qui claquent, aux mémos du patron et à la pluie qui revient, vous allez glisser dans votre poche les Petits crimes japonais de Kyōtarō Nishimura.
Vous allez le faire comme vous glisseriez un pli de documents confidentiels ou une dose d’arsenic dans votre imperméable, avec l’agilité d’une danseuse et le sang froid d’un lanceur de couteaux. Ni vu ni connu au milieu des passagers du métro, insoupçonnable, vous allez savourer avec un plaisir cruel et une pointe de gourmande culpabilité ces huit nouvelles du maître du polar nippon Kyōtarō Nishimura (Tokyo, 1930).
Soudainement, vous n’êtes plus dans votre bus, votre métro, votre cantine, mais dans un quartier mal illuminé de Tokyo, il neige et il fait noir, dehors et dedans. Une humanité de petits malfrats, de voleurs débutants, de policiers aux heures sup’ douteuses et d’aristocrates aux lubies discutables se succède : dans leurs cœurs n’ayant jamais battu plus vite ou plus fort que nécessaire, germent tout d’un coup de petites mauvaises graines. À votre gauche, un employé terne qui, après avoir aperçu un pickpocket dans le métro, frissonne à l’idée d’être capable à son tour de glisser sa main dans le sac d’un inconnu. Devant vous, un policier « au bon cœur » se dévouant pour subtiliser des broutilles des magasins pour qu’on désigne en coupables les clochards souhaitant passer l’hiver au chaud de la prison. À votre droite, au comptoir, un homme affirmant, sans la moindre inhibition, qu’il n’y a pas de plaisir plus intense que celui du meurtre. Autour de vous, une flotte de pigeons mystérieusement assassinés aux abords d’un temple.
Ces huit Petits crimes japonais ont la nonchalance diabolique des Crimes exemplaires de Max Aub (1957, réédités par Phébus Libretto en 2001) et le plaisir du précipice que provoquent chez le spectateur Les Nouveaux Sauvages de l’argentin Damián Szifrón (2014). Ils sont autant de petits voyages dans une Tokyo équivoque où on a le luxe de profiter de la malice des coupables et, parfois, du triomphe des innocents, d’être à la fois du côté de l’arroseur et de l’arrosé.
Dans les interlignes, on entrevoit le Japon et l’ombre grandissante de la vieillesse, on observe son attention, voire son engouement, pour l’écologie, on ramasse les victimes collatérales d’une vie d’entreprise souvent inhumaine. On goûte en somme, après la gourmandise du péché que la fiction nous autorise, le dépôt amer de la réalité qui reste en bouche en dépit du mot « Fin ».
(edg)