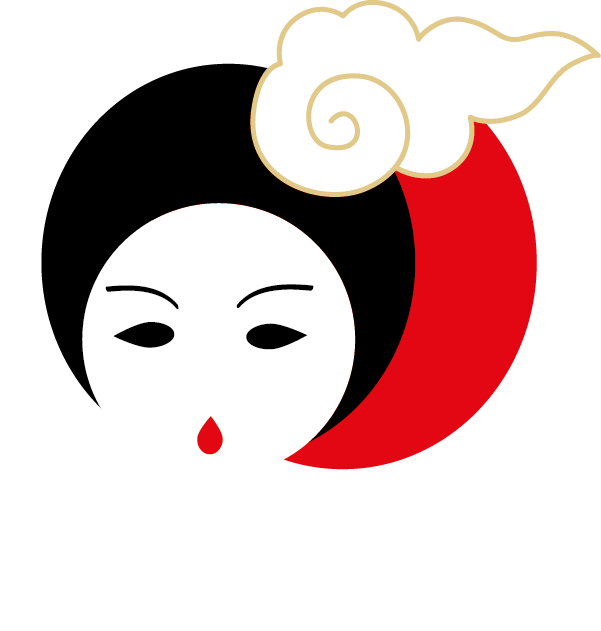« Néoréaliste », mais pas comme les Italiens. « Nouvelle vague », mais pas comme les Français. « Formaliste », mais à différence des poètes… Quand il s’agit de grands maîtres et, comme c’est le cas de Yasujiro Ozu dont le 12 décembre on célébrait à la fois l’anniversaire de la naissance et de la mort, quand il s’agit de maîtres que l’on découvre tard, la tentation de l’étiquette est bien trop vertigineuse. Comme si toute grande existence ou parabole créatrice se devait d’être inscrite dans un itinéraire cohérent et le plus possible linéaire. Mais ce n’est pas parce qu’Ozu se considérait lui-même comme un « fabricant de tofu, qui ne sait bien faire que du tofu » qu’une vie consacrée au cinéma et une production impressionnante de plus d’une soixantaine de films peuvent tenir en quelques adjectifs.
« Je ne sais préparer que du tofu… Je peux faire du tofu frit, du tofu bouilli, du tofu farci. Les côtelettes et autres recettes chic, je laisse ça aux autres réalisateurs. » — Yasujiro Ozu
Le « tofu » d’Ozu, c’est quoi ? C’est une trajectoire cinématographique qui, depuis des débuts baignés dans les références hollywoodiennes, en premier lieu Chaplin et Lubitsch, se dégage progressivement des influences étrangères pour devenir reconnu uniquement – et fort probablement à tort – pour un minimalisme absolu de l’expression. Parmi ses « plats signature », on retrouve le « plan tatami », si étranger à l’œil occidental : la caméra, figée à 90 cm du sol, se tient comme se tiendrait une personne assise sur un tatami. À cette hauteur, c’est non seulement un regard qui se dégage, mais une culture et, de là, toute une vision du monde. Autre marque de fabrique du cinéma d’Ozu sont ceux que l’historien du cinéma américain Noël Burch a baptisé les « pillow shots » (Pour un observateur lointain – Forme et signification dans le cinéma japonais, Paris, Gallimard/Cahiers du cinéma, 1983). Énigmatiques, décousus au premier abord du récit, ces quelques secondes où la caméra quitte les personnages et se fixe sur un objet, une « nature morte », un paysage que l’humanité semble avoir déserté – une télé allumée sur un match de baseball, des draps étendus et que le vent fait flotter, une bouilloire rouge posée sur le sol (par ici un supercut des pillow shot d’Ozu). Ces natures mortes témoigne d’un sens de l’impermanence, aussi bien culturel qu’existentiel, qui caractérise le cinéma d’Ozu. Les « choses » précède la venue de l’homme et lui survivront, faisant peu de chose de ses tourments et des remous de son existence.
« C’est la pensée d’Ozu : la vie est simple, et l’homme ne cesse de la compliquer en « agitant l’eau dormante ». Il y a un temps pour la vie, un temps pour la mort, un temps pour la mère, un temps pour la fille, mais les hommes les mélangent, les font surgir en désordre, les dressent en conflits » — Gilles Deleuze
Ses thèmes de prédilection, la famille et sa lente désagrégation, due autant aux bouleversements sociétaux du Japon du XXe siècle qu’au naturel éloignement des parents et des enfants, du passage de l’enfance, libre et arrogante, à la vie adulte, pacifiée dans l’acceptation d’un certain état des choses. Tout comme ses personnages, Ozu opposera d’abord une certaine résistance aux changements – il n’abandonnera le cinéma muet qu’en 1936 et le noir et blanc en 1958 – mais finira par se laisser transporter avec grâce, comme en témoigne la savante utilisation de la couleur rouge dans Fleurs d’équinoxe.
Ozu est souvent « réduit à sa grandeur », la critique laissant de côté tout ce qui n’adhère pas à l’image du réalisateur « le plus japonais de tous » et Ozu revendiquant lui-même sa propre fidélité à un certain nombre de sujets et de moyens expressifs, mais le foisonnement de sa production filmique et littéraire défie toute tentative de généralisation. Et sa trace demeure, dans la culture japonaise et dans l’histoire du cinéma, un peu moins impermanente.
(edg)