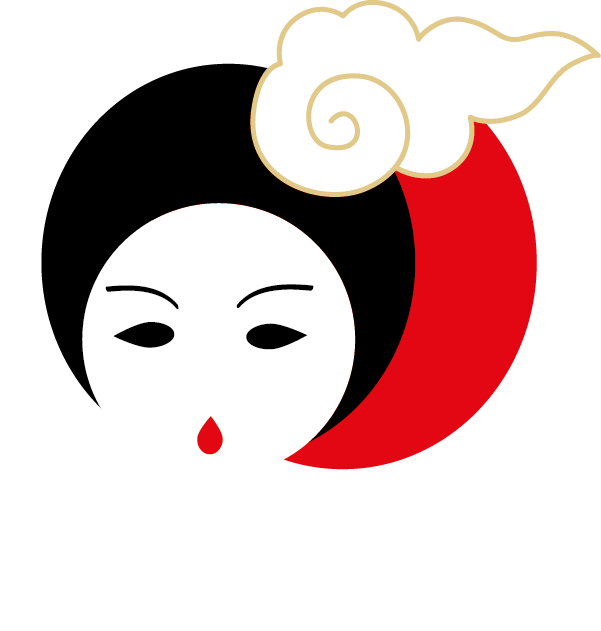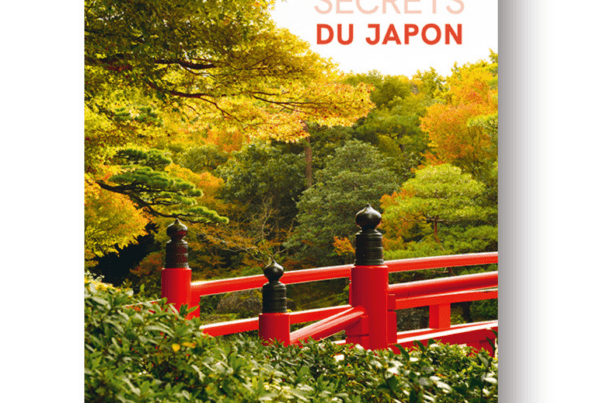« En dehors de cet archipel et de sa nature, de ces montagnes, de ces rivières, de ces forêts, de ces herbes… les Japonais n’existent pas. Ils sont unis à eux. Ils ne font qu’un seul corps avec tout cela. Si cette nature délicate et les îles sont détruites et disparaissent, les Japonais n’existent plus. » (Sakyo KOMATSU, La submersion du Japon, 1973).
En 2018, certainement pas pour la première fois et probablement pas pour la dernière, le Japon remportait la triste palme du pays le plus touché par des catastrophes naturelles avec 15% des amoureux de la planète. Cette même année, l’association de promotion des kanji, les idéogrammes japonais, avait voté « 災 », sai, comme symbole de l’année : « Désastre ». 2011, avec la catastrophe de Fukushima, et 2018, avec son lot de typhons, tsunamis et tremblements de terre, ont particulièrement marqué les esprits au sein et à l’extérieur de l’archipel : ils nous ont sensibilisé aux menaces qui pèsent sur ses épaules. Quand la nature était lasse de se déchaîner, les hommes et leur voracité l’ont vaillamment remplacée. Ainsi, l’énergie nucléaire, la pollution industrielle et les incendies ont rajouté leur lot de malheurs aux ravages des catastrophes naturelles.
Au fil des siècles, les Japonais ont forgé une culture fataliste du shikata ga nai (« c’est ainsi ») et une image internationale de peuple résiliant par essence. Comment survivre alors, voire vivre et donner du sens à la vie, dans un contexte qui quotidiennement nous renvoie à notre petitesse face à l’imprévisible toute-puissance des éléments ? Comme toujours, quand le bon sens ne suffit plus, l’art lui prête main forte.
L’Occident aura découvert une certaine beauté vertigineuse dans La grande vague de Kanagawa (1830) du peintre Hokusai où le mont Fuji, en arrière-plan, semble sur le point d’être englouti par la mer, ou encore dans les estampes représentant les incendies d’Edo, ancien nom de Tokyo. Au cours du XXème siècle, en raison des catastrophes naturelles et nucléaires, et avec un pic après 2011, les arts sous toutes leurs formes ont ressenti le besoin de mettre en scène, analyser, exorciser le désastre. Littérature, cinéma et manga ont décliné chacun à sa façon et selon les générations qui se l’appropriaient leur vision de l’apocalypse. On pensera au petit cœur atomique d’Astroboy d’Osamu Tezuka qui, dans les années 1950, s’oppose joyeusement aux ennemis. À la même époque débute une saga qui ne cesse de se décliner au présent, Godzilla, monstre issu d’un accident radioactif qui aura détruit Tokyo à maintes reprises. Dans les années 1980, l’homme et son aveuglement auront provoqué une nouvelle destruction de la capitale nippone qui sert de toile de fond à Akira de Katsuhiro Ōtomo. Puis la littérature scientifique et fictionnelle se sont emparées de – voire ont été emparées par – Fukushima et ses conséquences.
Idem pour les arts figuratifs, le manga, le cinéma. Les réalisateurs de films d’animation comme Hayao Miyazaki et Makoto Shinkai offrent, eux aussi, leur point de vue sur la détresse des hommes face à la nature, elle-même mise en détresse par les hommes, et invitent à la réflexion. Avec Les enfants du temps, Makoto Shinkai apporte sa vision de quadragénaire qui assiste à la bataille des jeunes générations contre le dérèglement climatique et met en scène deux personnages principaux à la posture opposée et pourtant complémentaire : Hodaka, adolescent très contemporain en rupture avec la société, et Hina, jeune fille qui vit avec les éléments atmosphériques une relation très spirituelle ancrée dans le shintoïsme.
Toujours à l’heure, voire en avance sur le présent, les artistes japonais ne cessent de nous indiquer la voie vers le désastre en même temps qu’ils nous apprennent à contempler l’impermanente beauté des fleurs de cerisier.